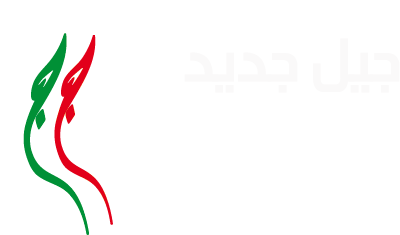Après sept vendredis de mobilisation historique qui ont abouti à la démission du chef de l’Etat, le mouvement contre le système est confronté à la grande tâche de la transition. Comment voyez-vous l’organisation de cette phase ?
Les Algériens viennent de réaliser une «révolution du sourire» sans l’avoir au préalable imaginé. Ce qui vient de se passer marquera l’histoire de ce pays.
Connaissez-vous un autre cas dans le monde où un peuple a chassé un autocrate avec un tel panache ? Connaissez-vous un seul autre peuple qui se soit mobilisé en centaines de milliers dans des dizaines de capitales et de villes à travers tous les continents, avec la même allégresse et le même enthousiasme ?
Le 22 février, les Algériens se sont découverts. Chacun pensait que la société algérienne s’était figée dans sa configuration des années 1990.
Elle vivait alors les démons idéologiques, le désarroi identitaire, l’exclusion, le sectarisme, la violence et le sexisme. Et voilà que tous découvrent, en un moment magique, une société souriante, tolérante, pacifique, beaucoup plus pragmatique, avec une jeunesse pleine de vitalité et d’intelligence.
Les Algériens ont repris confiance en eux-mêmes. D’un vendredi à l’autre, le mouvement a pris de l’ampleur et de la puissance et a forcé l’admiration des plus sceptiques.
En sept semaines, le régime politique est pratiquement tombé. La dernière béquille qui lui reste est l’article 102 dont l’application lui donnerait quelque chance – illusoire de mon point de vue – pour se régénérer.
La transition à venir se fera, à l’évidence, en dehors du carcan constitutionnel, si l’on veut sortir de la crise et mettre en place un véritable Etat de droit.
Faut-il geler la Constitution et permettre la mise en place d’un gouvernement de transition ?
La Constitution est aujourd’hui caduque dans ses dispositions organisant les institutions politiques. Elle a été annihilée par l’annulation des élections et par la volonté impérative de la rue, qui exige un nouveau régime politique.
Il n’est pas utile de s’accrocher maintenant à la lettre d’un texte qui a été tant de fois transgressé au gré du «prince» et qui n’offre aucune issue légale répondant à l’aspiration de tous.
Une Constitution est faite pour réguler un système politique, lui-même objet d’un consensus national. Il n’est pas raisonnable de vouloir soumettre la souveraineté d’un peuple à des procédures contraires à ses vœux.
Par ailleurs, une Constitution n’est pas en soi une nécessité absolue. De grandes démocraties ont su s’organiser sans avoir recours à ce type de loi. Ne comprenez pas par là qu’il serait inutile pour nous d’avoir une Constitution. Chaque pays a sa propre histoire.
Pour nous, il est nécessaire d’avoir un texte clair, qui régit les institutions et protège les droits et libertés des citoyens.
Pour revenir à votre question, il faudrait arriver rapidement à un consensus pour une période transitoire de 6 à 12 mois, avec une feuille de route réaliste et une présidence de l’Etat dirigée par un homme ou un comité accepté de tous.
Bien entendu, un gouvernement provisoire – en dehors des partis et surtout sans la participation des figures du régime déchu – devrait conduire les affaires du pays. Cette période devra déboucher sur une élection présidentielle.
C’est au futur président de la République d’engager ensuite les grandes réformes de l’Etat, à commencer par un processus constituant. Là aussi, permettez-moi de décliner mon choix : une «constituante» est une voie très périlleuse.
A mon sens, une large consultation menée par une présidence de la République légitime aboutira très vite à un accord : rendre la justice indépendante de l’Exécutif, mettre en place une Cour constitutionnelle autonome, rééquilibrer les pouvoirs en faveur d’un gouvernement représentatif d’une majorité parlementaire, donner de vrais moyens de contrôle de l’Exécutif aux députés et, surtout, mettre en place une vraie institution démocratique pour la gestion de tout processus électoral.
Le chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaïd Salah, est en première ligne depuis l’éviction de Bouteflika. Devrait-il discuter directement avec l’opposition ?
L’armée est interpellée par la situation actuelle. Elle a une large part de responsabilité dans cette fin chaotique du régime de Bouteflika. Maintenant, il s’agit de trouver rapidement les bonnes solutions. Le départ du régime ne doit en aucun cas signifier la déstabilisation de l’Etat.
Après avoir aidé à faire partir le clan présidentiel, le chef d’état-major sera forcément impliqué dans le choix de la composante de la présidence de l’Etat qui assumera la transition. Il serait bien inspiré de consulter, directement ou indirectement, la «société politique», c’est-à-dire autant les partis politiques que les syndicats ainsi que les personnalités nationales. Je suis persuadé qu’un accord sera vite trouvé.
L’essentiel est de dépasser rapidement le vide juridique actuel avec l’engagement de tous pour aller vers la mise en place d’instruments politiques transitoires convenables. Il aura à donner les garanties pour sécuriser l’Etat et le processus de retour vers la légitimité tant populaire que légale du pouvoir politique.
La rue redoute une reprise en main et la fermeture du jeu. Quel devrait être le rôle de l’institution militaire en cette période ?
Sincèrement, je pense que l’institution militaire est très consciente des enjeux. Même s’il devait y avoir quelques velléités personnelles, je reste persuadé qu’elle accomplira son rôle avec responsabilité.
L’armée algérienne a atteint aujourd’hui un haut niveau de professionnalisme. Bien entendu, certains de ses membres n’ont pas toujours été à la hauteur de leur mission, mais ne les confondons pas avec l’institution.
Malgré toutes les critiques qu’elle a subies, elle a été là lorsque le pays a eu besoin d’elle. Je suis persuadé qu’elle saura maîtriser son rôle dans la gestion de la transition et dans sa future place dans la nouvelle République.
Les Algériens s’interrogent sur le devenir du mouvement populaire. Quel prolongement politique doivent-ils lui donner pour amorcer le changement démocratique ?
Les Algériens ont redécouvert la politique au sens noble du terme. L’espace public est en train d’être réapproprié, en particulier par les jeunes. Les nouvelles générations ont un grand désir de contribuer à la construction de leur cité. Les étudiants se libèrent de nouveau et il faudra sans aucun doute compter avec cette jeunesse instruite dans la suite des événements.
Le mouvement du 22 février a été d’une telle ampleur qu’il ne peut qu’appartenir à la mémoire collective. Nous pouvons employer, dans ce cas, le terme de «peuple» sans forcer le trait.
Et le peuple a bien dit qu’il voulait participer à son destin. Autrement dit, il veut des règles du jeu claires, qui lui permettront de défendre ses idées et de contribuer à la prise de décision. C’est exactement cela, l’objet de la démocratie.
Le peuple aura à choisir librement ses représentants pour faire partie des institutions de la République. Il veut un pouvoir équilibré par des contre-pouvoirs. Il veut des représentants authentiques qu’il aura choisis.
Ce peuple-là est uni dans son algériannité mais divers dans son expression. Les Algériens sont en voie d’inventer leur propre modernité. J’ai le plus grand espoir que ce pays trouve enfin sa voie vers un avenir apaisé.