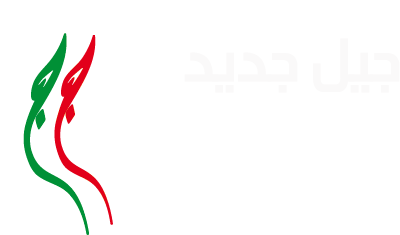Ahmed Ouared
J’aborde dans cette contribution un sujet sensible, qui peut déranger, voire heurter certains mais qui s’avère aujourd’hui indispensable même utile.
En parler clairement devient à mes yeux une nécessité si nous voulons comprendre ce qui s’est réellement passé et ce qui continue d’affecter nos villes et notre société.
Aborder ce sujet, ce n’est ni stigmatiser ni diviser c’est oser regarder en face les fléaux qui minent notre vivre-ensemble :
C’est tenter de comprendre.
Parce qu’aucune société ne peut se reconstruire en occultant les causes profondes de ses dérives.
Le recul du civisme, la montée de la violence gratuite, les incivilités devenues normales, l’anarchie architecturale, le délitement du lien social, la perte de l’âme urbaine.
Beaucoup s’en offusquent, d’autres refusent simplement d’en débattre.
Pourtant, détourner le regard serait nier une réalité qui façonne encore aujourd’hui notre quotidien : la transformation brutale de nos villes, la dégradation de leurs codes sociaux, et l’émergence de formes de violence et d’anarchie devenues banales dans de nombreux quartiers.
Il s’agit de l’exode rural en Algérie, des années 1970–1990. Ce phénomène a redessiné les villes, transformé les modes de vie et modifié jusqu’à la définition même du citadin.
Il n’a pas été un simple déplacement de population : il a été un bouleversement profond, rapide, massif, et souvent non accompagné par une vision d’aménagement du territoire.
Traiter et comprendre ce thème n’est jamais anodin. Il touche à notre histoire intime, à nos parcours familiaux, à nos blessures encore ouvertes. Beaucoup préfèrent éviter ce débat, d’autres y voient une accusation. Pourtant, fermer les yeux ne fait qu’aggraver les incompréhensions et les tensions qui traversent notre quotidien.
Il a été un tournant majeur : un basculement démographique qui a bouleversé nos villes, transformé leurs équilibres sociaux et contribué, parfois malgré lui, à l’émergence de fléaux bien visibles aujourd’hui — violence dans certains quartiers, anarchie urbaine, effritement du civisme, perte des repères collectifs.
Et puis il y a eu la décennie noire, qui a amplifié brutalement ces mouvements de population. Les villes se sont retrouvées submergées par un exode de détresse et de survie, sans cadre, sans accompagnement, sans planification.
Les traumatismes individuels se sont mêlés aux fractures urbaines, laissant derrière eux des espaces fragilisés où la loi du plus fort a trop souvent remplacé l’ordre public.
Nous ne pouvons comprendre l’Algérie contemporaine sans revenir sur ce basculement démographique massif qui, en quelques décennies, a bouleversé l’équilibre urbain du pays.
L’exode rural n’a pas seulement rempli les villes : il les a déstabilisées, elles n’ont pas absorbé les nouveaux arrivants : elles ont été débordées.
Des déplacements des populations entières déracinées, souvent livrées à elles-mêmes, à une époque où l’État n’était ni prêt, ni structuré, ni capable de gérer cette mutation.
1️⃣ Une urbanisation brutale, non planifiée et le sacrifice de la Mitidja.
Dans la continuité de ce déplacement massif, et l’urgence du logement, les autorités n’ont trouvé mieux que de sacrifier et de détruire lentement mais sûrement des terres agricoles des plus fertiles, des hectares entiers, de vergers et de champs d’agrumes et particulièrement celles de la Mitidja, ce joyau agricole, pour y construire des cités impersonnelles, sans âme et sans vision.
Ce choix, dicté par la pression démographique et l’absence de planification, a profondément appauvri à la fois l’agriculture et l’espace urbain.
Résultat :
☑️Une perte irréversible de terres arables.
☑️Des cités mal conçues, souvent livrées à l’anarchie.
☑️Une urbanisation étouffante autour d’Alger et de Blida.
Ce sacrifice de la Mitidja est l’un des symboles les plus frappants d’une urbanisation menée dans la précipitation, où l’on a échangé des terres d’une valeur inestimable contre des constructions fragiles et désordonnées.
L’exode rural a engendré une urbanisation sauvage, des extensions anarchiques des villes et de développement de quartiers précaires sans infrastructures, sans anticipation et sans harmonisation.
Toutes nos villes, jadis, avaient une cohérence architecturale ont fini par perdre leur âme, leur patrimoine urbain pour laisser la place à des constructions hideuses. Il est la résultante de la saturation des services publics, des écoles, des routes, des transports et des hôpitaux etc..
2️⃣La rupture des codes urbains.
Les villes algériennes avaient historiquement une culture urbaine très spécifique :
civisme, politesse, art de la cohabitation, sobriété architecturale, commerces de proximité, vie de quartier structurée par des règles non écrites.
L’arrivée massive de populations rurales — souvent elles-mêmes déracinées et confrontées à la survie a créé un choc culturel.
Les codes urbains n’ont pas été transmis.
Les nouveaux habitants n’ont pas eu le temps d’apprendre les pratiques citadines.
Les anciennes familles urbaines, elles, se sont senties envahies, puis se sont retirées ou ont émigré.
Résultat :
▶️ Disparition des comportements urbains traditionnels, remplacés par un mode de vie hybride, discontinu, parfois conflictuel.
3️⃣ Une urbanité dissoute dans la survie économique.
En ville, le passage de l’économie rurale traditionnelle à une économie urbaine formelle aurait dû s’accompagner de formation, d’intégration sociale, de politiques culturelles.
Rien de tout cela n’a eu lieu.
Les nouveaux citadins ont dû inventer leurs propres stratégies :
petit commerce, informalité, bricolage urbain, constructions illégales, étals sauvages.
Ce n’est pas de la “mauvaise volonté” : c’était une réponse à l’absence totale d’encadrement.
Conséquence :
▶️ L’espace urbain est devenu un terrain d’adaptation improvisée plutôt qu’un lieu organisé et civique.
4️⃣ Le poids du déracinement
L’exode rural a fait naître une population citadine sans mémoire urbaine et sans attache rurale vivante.
Les nouveaux arrivants :
ont quitté leur village mais n’ont pas trouvé d’identité urbaine à adopter,
ont perdu leur organisation communautaire traditionnelle,
se sont retrouvés dans des villes où chacun cherche à survivre individuellement.
Cette situation a créé une identité urbaine “en suspens”, fragile, instable.
5️⃣ La ville comme refuge, non comme projet de vie.
Pour beaucoup, la ville algérienne n’a pas été un choix, mais une nécessité :
fuir la pauvreté, l’ennui rural, le manque d’emploi, ou plus tard le terrorisme.
Quand on s’installe en ville par contrainte :
☑️on ne s’y projette pas,
☑️on ne s’y sent pas responsable,
☑️on ne la considère pas comme un bien commun.
Résultat :
➡️ Le rapport à la ville devient fonctionnel, individuel, et non collectif.
6️⃣ Effacement de l’ancienne âme urbaine.
Les anciennes villes algériennes avaient une atmosphère :
une élégance discrète,
une sociabilité structurée,
une culture du respect,
un équilibre entre tradition et modernité.
Cet esprit urbain — celui d’Alger, Blida, Constantine, Oran, Tlemcen, par exemple — a été progressivement submergé par :
☑️la densité,
☑️l’informalité,
☑️la standardisation,
☑️la perte du bâti ancien,
☑️le bruit, la circulation, l’extension horizontale sans fin.
☑️L’âme de la ville a été diluée dans le chaos urbain.
Conclusion :
Une transformation non accompagnée.
L’exode rural n’est pas en soi un problème. Dans d’autres pays, il a même revitalisé les villes.
Ce qui a posé problème en Algérie, c’est l’absence :
☑️d’aménagement du territoire,
☑️de gestion urbanistique,
☑️de transmission culturelle,
de projet de société.
L’exode rural a dénaturé les villes algériennes parce qu’il a été laissé sans cadre, sans vision, sans médiation sociale.
Il a produit des citadins sans urbanité et des villes sans âme.
A. OUARED