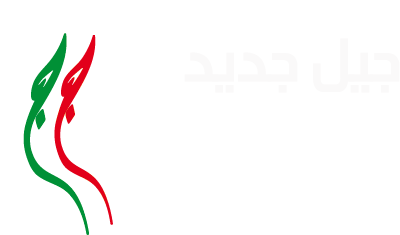Ontogénie du système politique algérien
Par Soufiane DJILALI
Une pensée stérile conduit à une action aveugle.
Dr. Al Ajâmi
Dans une précédente contribution, intitulée « La fin d’une époque », j’ai voulu mettre des mots sur la conviction de nos concitoyens que quelque chose n’allait plus dans le pays. Qu’ils soient opposants ou soutiens au pouvoir, tous perçoivent un profond malaise dans la République et comprennent que, au-delà du personnel dirigeant, c’est le système politique lui-même, érigé depuis 1962, qui a atteint ses limites et qu’il est désormais caduc.
Le plaidoyer pour une seconde République n’est pas nouveau en Algérie mais l’idée a maintenant mûri. Il est vrai que ce concept renvoie à une expérience historique que beaucoup d’Etats ont déjà vécu. L’instauration d’une nouvelle République signifie des changements profonds des structures organisationnelles ainsi que des élites dirigeantes. Ce phénomène est advenu à plusieurs reprises en Europe accompagnant la modernisation de leurs Etats. Mais il y a bien plus longtemps encore, les différentes dynasties régnantes au Maghreb se succédaient elles aussi, tout autant et selon des dynamiques de pouvoir qu’Ibn Khaldoun, dès le XIVe siècle, avait brillamment décrit.
En Algérie, la restauration de l’Etat, qui avait été annihilé par 132 ans d’occupation française, prit immédiatement la forme d’une République, dont la légitimité, l’organisation et la doctrine furent le prolongement naturel du mouvement de libération nationale. Toutefois, après 63 ans d’indépendance, le sentiment général est que le pouvoir algérien est resté le même, figé dans sa configuration première.
Tout bouge pour que rien ne change
Pourtant, la scène politique n’a pas été immobile, loin s’en faut. Depuis l’indépendance, il y a eu 10 Chefs de l’Etat dont 6 Présidents de la République et 4 autres Présidents de l’Etat en interrègne. L’armée connut à sa tête, elle aussi, une pléthore de responsables. Quant aux multiples gouvernements, les Algériens ne reconnaissent même plus les visages et les noms de l’infinité de ministres qui se sont succédés, dont une bonne partie dans une forme d’anonymat complet.
Par ailleurs, les différents Présidents de la République ont tous constitué très largement leurs équipes. En réalité, chacun d’eux a institué une politique générale et un style de gouvernance qui lui étaient propre. Pourtant, pour les observateurs, à chaque fois, tout bouge pour que rien ne change. Bien qu’il ne s’agisse pas des mêmes décideurs, des mêmes dirigeants et des mêmes politiques, il y a, au-delà de tout, une permanence de structure, de comportements, de mentalité et de discours qui impriment au réel, la manifestation d’un « système » trônant au-dessus des hommes.
Entre un Ben Bella volontariste, un Boumediene austère, un Chadli réformateur, un Zeroual patriote, un Bouteflika libéral ou un Tebboune administrateur, les styles, les options, les convictions et les projets diffèrent mais, fondamentalement, l’esprit et l’architecture étatique n’évoluent pas.
Finalement, les hommes se succèdent, mais le « système » reste en place. Mais quel est donc ce système ? Comment le définir ? Comment diagnostiquer ses points forts et ses points faibles ? Comment, le cas échéant, le réformer ?
Un système politique résilient
Le système politique, érigé en 1962 a été le résultat stratégique d’une volonté d’un peuple de se défaire des contraintes structurelles et politiques d’une domination extérieure. Ce système avait été conçu et édifié dans le feu de l’action libératrice et dont les objectifs étaient le rétablissement de la souveraineté nationale et la reconstruction d’un Etat moderne et social en réaction à l’occupation étrangère, au sous-développement et aux injustices du système colonial. Dans l’esprit des futurs bâtisseurs de l’Etat de la première génération, il fallait imposer une architecture d’un pouvoir qui sécurise dorénavant l’indépendance du pays tout en se donnant les moyens de contrôler la population pour assurer sa stabilité politique et son essor socio-économique. Tels étaient, en tout état de cause, les objectifs annoncés.
Or, en 1962, seuls ceux qui avaient combattu le colonialisme, au risque de leur propre vie, pouvaient légitimement réclamer la direction politique du pays. Leur vision du monde provenait directement de l’action révolutionnaire. Rappelons qu’à cette époque, la majorité écrasante de la population était illettrée, que la technostructure étatique s’était effondrée avec le départ massif des anciens occupants et que l’élite politico-administrative autochtone naissante n’avait aucune expérience de la gestion de l’Etat. Il n’y avait donc pas le choix : la légitimité révolutionnaire (puis historique) devait remplacer une impossible légitimité populaire à l’évidence hautement hasardeuse ; les conditions d’une démocratie étant alors inexistantes.
Nonobstant les conflits idéologico-politiques au sein même du mouvement national, il fallait faire face très rapidement aux multiples défis qui se dressaient devant la nation. Dès lors, un système politique volontariste, fermé et autoritaire, construit autour de ce qui sera appelé plus tard, au moment de la crise islamiste, « la famille révolutionnaire », était probablement la seule issue possible. A contrario, une conception démocratique du pouvoir était considérée comme une approche offrant une structure d’Etat trop faible et fragile, voire dangereuse, face aux dissensions intestines et à de potentielles ingérences étrangères sous forme d’un néocolonialisme ; situation qui remettrait en cause les objectifs ultimes de la révolution.
Il faut dire que dans le contexte des années 60, le modèle des « démocraties populaires » était la seule alternative. L’Armée de Libération Nationale (ALN) devenue l’Armée Nationale Populaire (ANP) était, dans cette Algérie renaissante, l’unique structure institutionnelle suffisamment organisée et disciplinée et surtout digne de confiance : elle constituera la colonne vertébrale du nouvel Etat. La décision stratégique, la sécurisation de la souveraineté nationale et la stabilisation du pouvoir politique en dépendaient. Quant aux orientations politiques et la structuration de la société, elles devaient relever du parti unique, le FLN, dans la continuité de sa déclaration du 1er Novembre 54.
Rappelons que la genèse de tout Etat est en relation directe avec la sécurisation d’une population relativement homogène, liée par un sentiment d’appartenance nationale. L’Algérie ne pouvait faire exception. Ainsi, dès Juillet 1962, la dynamique du pouvoir mua, passant d’une décentralisation politique créative d’une révolution collective et populaire à une autorité pyramidal rigide et impérative, justifié par les nécessités de l’émergence d’un système étatique. Sans un ordre imposé par l’autorité militaro-politique, le pays était guetté par le chaos.
Le dépassement des tensions entre les différents groupes de Moudjahidines ayant participé à la libération du pays selon une responsabilité horizontale devait se faire par l’établissement d’une gestion verticale du monopole de la violence. Sans cela, l’édification de l’Etat devenait impossible et l’échec assuré.
La libération du pays s’était faite grâce à l’engagement spontané de tout le peuple. La construction de l’Etat, par contre, ne peut être réalisée que par une élite formée à cet effet. Or, pour des raisons évidentes, et en dehors de quelques individualités, cette élite politico-administrative n’était pas là. C’est ainsi que les chefs de l’armée, après les toutes premières années erratiques de l’indépendance, ont eu recours d’abord à un « conseil de la révolution » décisionnaire avant de transférer le pouvoir effectif à l’homme qui, parmi eux, avait su et pu imposer son autorité.
Les premières conséquences d’une telle démarche en découlèrent naturellement : fermeture de l’espace politique, absence de libertés d’expression et de critique, désignation par le haut des « représentants du peuple ». Ceux qui avaient pris les armes pour libérer le pays allaient, de fait, le diriger à l’indépendance.
Le pouvoir vertical finit par pacifier l’autorité militaro-politique et par engager l’édification des premières structures de l’Etat moderne. La ferveur révolutionnaire, l’euphorie de l’indépendance acquise, la solidarité forgée par le combat libérateur et une sélection des ressources humaines contrôlée et restrictive ont permis, dans une première phase, de mobiliser les énergies de la nation puis d’engager un processus de développement socialisant.
Rien ne dure
Cependant, ce qui pouvait se justifier comme une première étape dans l’édification de l’Etat renaissant, perdurera bien au-delà des nécessités. Ce qui devait être un moyen temporaire s’est vite transformé en un but en soi. Alors que cette démarche avait favorisé le décollage socio-économique dans les premières années de l’indépendance, elle finit par engendrer, avec le temps, des déviances et des dysfonctionnements qui allaient constituer des boucles rétroactives négatives. Un centralisme politique, une économie d’Etat mal gérée, une administration socialo-bureaucratique et un autoritarisme stérile ont alors enfermé le pays dans une gangue paternaliste, populiste et laxiste.
Idéologiquement, le pays s’était naturellement engagé dans la voie progressiste et anti-impérialiste. Par syllogisme, l’anticolonialisme était relié à un rejet du capitalisme (l’élite en formation ne pouvait être que « socialiste »), phénomène accentué par l’origine populaire de la révolution qui, de ce fait, avait assigné au projet de société un objectif de « justice sociale », légitime en soi mais qui, face au réel, s’est vite transformée en rhétorique démagogique créant au surplus une frustration et un ressentiment généralisés.
Les nécessités de la sécurité interne au pouvoir amplifiées par les multiples divergences au sein du mouvement national, ont alors justifié un népotisme, un régionalisme et un clanisme au nom de la loyauté aux dirigeants qui allaient étouffer l’Etat et engendrer les premières ruptures entre gouvernants et gouvernés. Ce phénomène a été aggravé par les choix économiques centralisateurs qui ont annihilé l’esprit d’entreprise et développé l’assistanat. Malgré les bonnes volontés et les discours enflammés, la réalité socio-économique ne suivait pas les promesses. Seule la rente des hydrocarbures permettait cependant de combler les déficits et les erreurs de gestion et de calmer des besoins sociaux en pleine expansion. Elle ouvrit, également la porte à l’économie rentière et à la prédation naissante.
Octobre 88 a été alors la première déflagration interne significative due aux contradictions du système. Ayant compris la nature rigide du fonctionnement de l’Etat et les déséquilibres pathologiques qu’il induisait, le pouvoir tenta une ouverture pour créer une marge de manœuvre. La société elle-même, bousculée par une modernité occidentale qu’elle ne maitrisait pas, s’est retrouvée dans la tourmente. Sortant violemment des repères d’une société traditionnelle devenue anachronique et devant un échec patent d’une modernisation impensée, les Algériens avaient alors plongé dans une crise identitaire névrotique. Les tensions accumulées sur trois décennies d’indépendance n’ont pu être évacuées pacifiquement. Le chaos s’installa durant une décennie complète avant que le système n’ait pu retrouver un tant soit peu un équilibre, bien que temporaire.
Une restauration fragile
Le traumatisme du terrorisme des années 90 et le baume apporté par une rente pétrolière exceptionnelle dans les années 2000 ont donné au système politique un répit supplémentaire d’une vingtaine d’année. Tout en gardant la haute main sur l’ensemble des rouages du pouvoir, le régime tenta de prolonger l’expérience libérale entamée à la suite de l’effondrement financier et économique au tournant des années 90. D’un socialisme doctrinaire, l’Algérie devait passer à un libéralisme débridé. La liquidation de l’industrie du secteur public au profit d’une oligarchie arriviste et opportuniste transforma le pays en un bazar sans objectifs sinon celui de la privatisation du pouvoir et de son économie à l’image d’une Russie post communiste. C’est alors qu’en miroir d’Octobre 1988, Février 2019 mit un terme à cette dérive. En effet, dans un mouvement citoyen exceptionnel, les Algériens exigeaient un profond changement politique et des réformes structurelles qui mettraient le pays en phase avec le monde.
Malheureusement, malgré les promesses, le nouveau pouvoir reproduisit le même schéma de conduite que ses prédécesseurs, réactivant en cela, les mêmes mécanismes du système toujours actif. Mais la résilience d’un mode de gouvernance ne signifie pas progrès. Tout au contraire, plus un système anachronique perdure et plus il dégrade le pays. Aujourd’hui, l’Etat est entré dans une phase dysfonctionnelle aggravée.
En effet, avec le temps, le capital symbolique de la révolution et la légitimité du pouvoir qui en dépendait se sont effrités. Les premiers dirigeants ont disparu et avec eux leur aura de révolutionnaire. Dans l’imaginaire populaire, les dirigeants n’ont maintenant plus de légitimité. Le hiatus entre gouvernants et gouvernés n’a pas cessé de s’élargir.
Face aux crises qui se répètent cycliquement avec des délais de plus en plus courts, le « système », inconscient des vrais enjeux, a toujours recours à la répression tout en jouant d’une fausse ouverture politique accompagnée de mesures populistes. Pris dans cette dynamique, sa tendance profonde, s’accentua après la crise de 2019. Pour éviter le pire, il s’est convaincu qu’il fallait revenir à la formule fondatrice : prise en main sécuritaire, fermeture politique, contrôle absolu de l’information, gestion centralisée de l’économie, distribution arbitraire de la rente…
Plus le peuple réclame le changement et plus le pouvoir se raidit. Plus le besoin de la libre parole croît et plus le pouvoir bâillonne les citoyens. Moins il a le contrôle sur les esprits et plus il devient vindicatif et violent.
Aujourd’hui, le pouvoir est démuni face à la société : il a perdu la légitimité historique, la confiance populaire et même sa cohésion interne. L’Etat a perdu son aura et son autorité morale. Ses institutions sont toutes démonétisées trop souvent corrompues. Il n’y a pratiquement plus d’intermédiation crédible avec le peuple sinon les forces de police et la main de fer d’une justice aux ordres. Le système dégénère en des formes de gestion archaïque neutralisant toutes les institutions et contre-pouvoirs constitutionnels. Pris de soubresauts, il s’attaque à ses propres serviteurs, il détruit les hommes qui l’ont servi et il engendre la peur chez ceux-là même qui sont sensés le conduire. Seule la force brutale et une propagande primitive restent à sa disposition. Jusqu’à quand ?
Il est donc devenu impératif d’apporter les réformes fondamentales pour reconstruire nos institutions tout en éliminant les causes structurelles de l’échec politique et en prenant en compte l’expérience malheureuse de l’ouverture débridée et impensée post 88.
Quelles réformes ?
Aujourd’hui, nous pouvons tirer un premier bilan et résumer les défauts structurels de notre système politique de manière à réfléchir à la meilleure façon de les amender : hyper-présidentialisme qui dérive trop souvent en zaïmisme, Institutions élues factices, absence d’une vision stratégique, gestion anachronique, népotisme et clientélisme, médiocratie, domination de l’exécutif par l’administration, limitation des libertés individuelles et collectives, subordination de l’économie à l’arbitraire des intérêts privés du pouvoir, instrumentalisation des partis politiques transformés en annexes propagandistes, médias assujettis, justice aliénée etc.
Une vraie évolution politique de l’Algérie par un changement de République, ne pourra se réaliser qu’à travers une réforme profonde des défauts d’architecture du pouvoir actuel. Un débat national devrait être ouvert. Les décideurs sont interpellés pour avoir le courage de mettre sur la table les questions fondamentales autour desquelles devraient être dégagé un consensus à minima pour concevoir et édifier l’Etat algérien pérenne qui devra durer par-delà les hommes et les évènements ! C’est le destin d’une nation qui est en jeu !